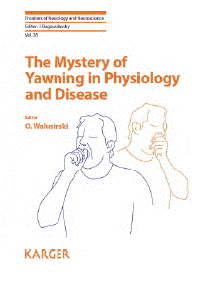-
- Résumé
- Le bâillement est une
stéréotypie comportementale
observée chez tous les
vertébrés, qu'ils vivent dans les
airs, sur terre ou sous l'eau, qu'ils soient
homéothermes ou poïkilothermes. Cet
article propose une mise au point de la
physiologie du bâillement et des
différentes pathologies qui lui sont
associées. L'évolution du
bâillement au cours de la vie fœtale,
la place qu'il occupe dans la physiologie de
l'intéroception complète cette
revue. Enfin, une théorie de sa
finalité physiologique est
proposée abordant les échelons
comportementaux et cliniques, l'échelon
des réseaux neuronaux et l'échelon
moléculaire qui le sous-tendent.
-
- Abstract
- Yawning is a behavioral stereotypy observed
in all vertebrates, whether they live in the
air, on land or underwater, and whether they are
homeotherms or poikilotherms. This article
reviews the physiology of yawning and the
various pathologies associated with it. The
evolution of yawning during fetal life and its
place in the physiology of interoception
complete this review. Finally, a theory of its
physiological purpose is proposed, addressing
the behavioral and clinical, neural network and
molecular levels that underlie it.
-
- Le bâillement est une
stéréotypie comportementale
observée chez tous les
vertébrés, qu'ils vivent dans les
airs, sur terre ou sous l'eau, qu'ils soient
homéothermes ou poïkilothermes. Ces
caractéristiques attestent de son
ancienneté phylogénétique
qui est corrélée à sa
précocité ontogénique.
Malgré son apparition quotidienne
associée aux rythmes veille-sommeil et
fin-satiété chez tous les
vertébrés, le bâillement
demeure un objet de très peu
d'études scientifiques, sauf,
peut-être parmi nos collègues
éthologues [1].
-
- Description d'un
bâillement
- Comportement involontaire, paroxystique et
stéréotypé, le
bâillement se caractérise par une
large ouverture de la bouche accompagnée
d'une profonde inspiration, suivie d'une
brève acmé en apnée
à thorax plein, puis d'une expiration
passive. Ce grand mouvement buccal n'est qu'un
élément d'un mouvement
coordonné complexe associant une flexion
suivie d'une extension du cou, simultanée
d'une ample dilatation du pharyngo-larynx qui
s'abaisse alors à son maximum. La
puissante contraction diaphragmatique
associée permet l'ample inspiration,
celle-ci contribuant à une redistribution
du surfactant alvéolaire
améliorant la compliance pulmonaire. Les
muscles faciaux se contractent. Les mouvements
de la tête font partie intégrante
du cycle ouverture/fermeture de la bouche
nécessaire à la mastication,
à la déglutition, à
l'élocution, au chant comme au
bâillement [2]. D'un point de vue
phylogénétique, chez toutes les
espèces, ce couplage fonctionnel a une
valeur adaptative, sélectionnée,
car elle assure une meilleure capacité
à saisir des proies mais aussi à
se défendre et à combattre. La
contraction de l'orbiculaire de l'œil
explique l'épiphora temporaire,
résultant de la compression du canal
lacrymo-nasal. L'ouverture de la trompe
d'Eustache contemporaine aboutit à une
baisse de l'audition et un sentiment d'isolement
du monde environnant [3,4]. Notamment
après l'éveil, la puissante
contraction de tous les muscles du corps luttant
contre la pesanteur enclenche un
étirement des quatre membres et une
hyperlordose qui, associés au
bâillement, se nomme une pandiculation. Ce
phénomène est fréquemment
observé chez les mammifères
carnivores au sortir du sommeil
post-prandial.
- Un bâillement dure 5 à 10
secondes. Cinq à dix bâillements
quotidiens sont une moyenne. Il existe des
petits bâilleurs et des grands
bâilleurs à l'image des petits et
des grands dormeurs [5,6]. Les
bâillements surviennent surtout
après l'éveil et dans la
période précédant le
sommeil, lorsque la faim se fait sentir ou en
période post-prandiale [7].
Bâiller est le plus souvent associé
à une brève sensation de
bien-être. Très
stéréotypé lors de son
déclenchement involontaire, le
bâillement, chez l'Homme, peut être
volontairement limité dans l'amplitude de
son extériorisation mais pas
inhibé totalement [8].
-
- Différents
bâillements
- Une des caractéristiques de ce
comportement est d'être transitionnel
entre deux états [8]. Les
organismes vivants, en particulier les
vertébrés, exhibent des
comportements variés, essentiels à
leur survie, caractérisés par
leurs récurrences cycliques [9].
Ont cette caractéristique deux
comportements fondamentaux de la vie : la
vigilance (être apte à survivre
face aux prédateurs alors que le sommeil
est indispensable à l'homéostasie
du cerveau) et l'alimentation (capter de
l'énergie). Les bâillements et les
pandiculations, en restant morphologiquement
identiques, apparaissent associés
à tous les états transitionnels
des rythmes infradiens et circadiens qui
caractérisent ces comportements. Les
transitions comportementales des animaux ne
résultent pas d'une adaptation passive
aux conditions d'environnement mais
obéissent à des stimuli internes
caractérisant les adaptations
homéostasiques
générées par l'hypothalamus
(noyaux suprachiasmatiques, noyaux
paraventriculaires). Les horloges biologiques
internes autorisent une adéquation
précise entre besoins métaboliques
(faim / satiété), les rythmes
veille / sommeil (fonction de l'alternance
lumière / obscurité) et les
conditions d'environnement (avec entre autres,
une adaptation musculaire tonique à la
pesanteur) [10].
-
- La reprise de la capacité motrice des
reptiles, poïkilothermes et ectothermes,
une fois atteinte la température
corporelle adéquate grâce au
réchauffement solaire,
s'extériorise par un bâillement
avant d'entamer leur locomotion
[1].
- Seulement reconnaissables chez les
mammifères et certains oiseaux, des
bâillements apparaissent après un
épisode de stress, témoignant de
l'effet apaisant qu'ils procurent.
L'éthologie qualifie de «
displacement activity » ce type de
comportement [11]. Observés, par
exemple, chez les chiens dans une salle
d'attente de vétérinaires, chez
des chimpanzés trop nombreux dans un
enclos de captivité, ces
bâillements, contrebalançant le
stress, sont aussi exprimés par des
sportifs avant une compétition ou les
gens du spectacle avant d'entrer en scène
[12]. Générés par
l'hypothalamus et régulés par le
système limbique [13], ces types
de bâillements peuvent être
rapprochés de ceux associés
à la sexualité dans certaines
espèces telles certains rats ou des
macaques. Le mâle dominant bâille
avant le bref accouplement comme pour afficher
son statut au sein d'un groupe
hiérarchisé. Le caractère
testostérone dépendant de ce type
de bâillements a pu être
démontré [14].
-
- Enfin, certaines rares espèces sont
capables d'une réplication
comportementale ou échokinésie du
bâillement, alias contagion (terme
inadéquat puisqu'il n'y a pas de
transmission de pathogènes)
[15,16].
- Les grands singes dont l'Homme, les
éléphants, peut-être
certaines espèces de rats, sont
doués de cette capacité. Dans
certaines conditions de dressage et de vie
commune prolongée, certains chiens et
certains perroquets semblent sensibles aux
bâillements de leur maître mais pas
à ceux de leurs congénères.
Notons, néanmoins, que certains rares
auteurs contestent le rôle de l'empathie
comme mécanisme neuropsychologique
nécessaire à la réplication
du bâillement. [17]. Ils proposent
de ne voir dans ce phénomène qu'un
mécanisme de mimétisme moteur
automatique de bas niveau, sans lien avec la
théorie de l'esprit, c'est-à-dire
la capacité cognitive d'inférer
l'état mental de l'autre. Mais, dans ce
cas, comment comprendre l'absence de
généralisation de ce
phénomène à de nombreuses
espèces ? En effet, seules les
espèces en capacité de se
reconnaître dans un miroir, c'est à
dire d'avoir une certaine capacité de
raisonner sur elles-mêmes, sont aussi
sensibles à la réplication du
bâillement de l'autre,
phénomène apparaissant au sein
d'une vie d'interactions sociales
élaborées et
hiérarchisées (et lire
ci-après) [18].
-
- Les modalités de cette
réplication sont visuelles, auditives ou
olfactives [19]. Les animaux vivant en
groupe sociaux ont des rythmes d'activité
plus ou moins synchrone. Leurs éveils
simultanés, accompagnés de
bâillements, peuvent être
interprétés à tort comme
des réplications alors qu'il ne s'agit
que de synchronies d'états physiques.
-
- Chez l'Homme seulement 70% de la population
est sensible au bâillement d'autrui. Les
traits de personnalité empathique versus
personnalité alexithymique expliqueraient
cette proportion [20,21]. Il n'existe
pas de différence en fonction du sexe
biologique chez l'Homme alors qu'une telle
différence existe chez les
chimpanzés et les bonobos. Le dominant
déclenche plus de bâillements chez
ses congénères de sa troupe que
les autres membres [22].
-
- Cette capacité mimétique
n'apparaît chez l'enfant qu'après
l'âge de trois ans. Cette maturation
neuropsychologique nécessaire
témoigne de l'acquisition de la
capacité d'inférer l'état
mental d'autrui, de façon automatique et
involontaire, c'est-à-dire d'activer les
circuits corticaux et sous corticaux
sous-tendant la théorie de l'esprit
[23,24].
-
- Ces bâillements
répliqués sont un mode de
communication non verbal adapté à
une vie sociale en groupe des grands singes et
des éléphants. Dans ces deux cas,
le bâillement d'un gardien ou d'un cornac
peut enclencher le bâillement d'un
chimpanzé captif ou de
l'éléphant cornaqué
[25]. Le bâillement illustre ainsi
comment l'Évolution a pu recycler un
comportement, conservé morphologiquement
à l'identique, dans des fonctions
différentes.
-
- Lire
la suite
-
|