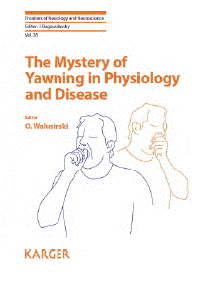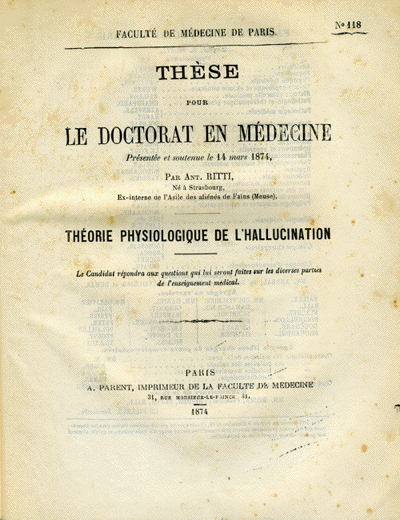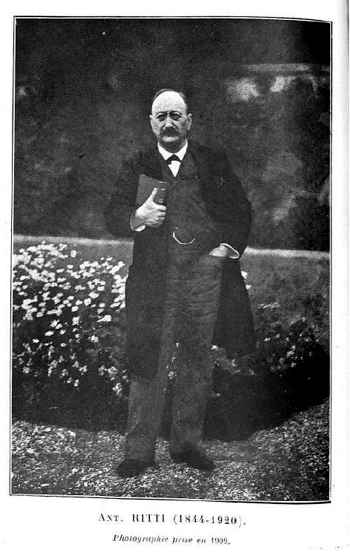-
- Antoine Ritti
(1844-1920), aliéniste
oublié, concepteur novateur de la
physio-pathologie des hallucinations
-
- Antoine Ritti (1844-1920) est un
"aliéniste" oublié, concepteur
d'une théorie des hallucinations
basée sur un dysfonctionnement du
thalamus, exposée dans sa thèse
soutenue en 1874. Elève de Jules Luys, il
utilisa les découvertes
anatomico-fonctionnelles de son maître
pour expliquer qu'une activité
automatique du thalamus, stimulant le cortex
sans réception d'informations
sensorielles, autonomisait, spontanément
en quelque sorte, des représentations
perçues par le malade et non pour son
entourage. Ce concept novateur d'un rôle
des structures sous corticales dans le
fonctionnement cognitif élaboré
trouve actuellement pleinement son sens mais fut
ignoré pendant plusieurs décennies
après ses travaux.
-
Antoine Ritti
(1844-1920) was an "alienist", now
forgotten, who formulated a theory of
hallucination based on thalamic dysfunction, as
described in his thesis defended in 1874. Ritti
was a student of Jules Luys and used the
anatomical-functional discoveries of his teacher
to explain that an automatic activity in the
thalamus, by stimulating the cortex without
reception of sensory information, made
representations perceived by the patient (but
not his entourage) autonomous, a process
occurring spontaneously to some degree. This
innovative theory, which gave subcortical
structures a role in high-level cognitive
function, is very resonant today but was ignored
for several decades after Ritti published his
work.
- L'hallucination, du latin hallucinare, se
tromper, garde à ce jour la
définition qu'en a proposé
Jean-Etienne Esquirol (1772-1840) en 1817:
« conviction intime d'une sensation
actuellement perçue, alors que nul objet
propre à exciter cette sensation n'est
à portée des sens ». Il
ébauche, à la suite, une
conception physiopathologique : « Les
prétendues sensations des hallucinations
sont des images, des idées, reproduites
par la mémoire, associées à
l'imagination, et personnifiées par
l'habitude ».
-
- En effet, depuis François
Boissier de Sauvages (1706-1767) et sa
« Nosologia Methodica » (1768), si
elles sont classées parmi les maladies
mentales en «tintouin» (perception
imaginaire claire d'un son clair et aigu qui
n'existe point hors de l'oreille) et en
«vision» (perception imaginaire d'un
objet visible qui n'existe point en dehors de
l'œil) leur explication est
rapportée à des lésions des
organes des sens, conception reprise par Achille
Foville (1799-1878) en 1824 et Louis-Forentin
Calmeil (1798-1895) en 1849.
-
- En 1842, Jules Baillarger (1809-1890)
considère que « la nature des
hallucinations est très diversement
comprise par les auteurs; les uns les
considèrent comme un symptôme
purement physique, dont le bourdonnement
d'oreilles est le degré le plus simple;
les autres les regardent comme une espèce
particulière de délire qui ne
diffère des conceptions
délirantes, en général, que
par sa forme. Pour les uns, les
hallucinés sont réellement
impressionnés comme s'ils voyaient et
entendaient, etc.; pour les autres, au
contraire, ces malades se trompent, et
n'éprouvent rien de ce qu'ils disent
». Dans l'introduction de son livre «
Des hallucinations » paru en 1852,
Alexandre Brierre de Boismont (1797-1881) les
définit ainsi: « Voir ce qu'aucun
œil ne contemple, entendre ce qu'aucune
oreille ne perçoit, être convaincu
de la réalité de sensatiions qui
ne trouvent que des incrédules »
mais reste dubitatif sur leur causes : «
Les recherches entreprises sur les
lésions cadavériques de la folie
ne nous faisaient rien présager de
satisfaisant pour l'hallucination; aussi
partageons nous sur ce point l'opinion de la
grande majorité des médecins, qui
pensent que l'anatomie pathologique des
hallucinations est encore à faire
».
-
- On retrouve là toutes les
difficultés conceptuelles
rencontrées par les aliénistes du
XIX° siècle. En effet, par
opposition aux conceptions morales et
religieuses dites romantiques de la folie,
prévalant à la fin du XVIII°
siècle en Europe, apparaît au XIX
° siècle un grand débat sur
l'origine anatomo-pathologique de la folie,
notamment à la suite de
l'individualisation, en 1822, par Antoine Bayle
(1799-1858) de la paralysie
générale, et des doctrines de
l'anatomiste Franz Gall (1758-1828), fondateur
de la phrénologie, à l'origine des
recherches « sur les localisations
cérébrales ».
Benedicte-Augustin Morel (1789-1873),
élève de Claude Bernard,
développera la théorie « des
dégénérescences » afin
d'expliquer les cas dans lesquelles aucune
lésion à l'examen autopsique ne
peut expliquer les troubles mentaux du malade
(Bogousslavsky, 2011). Tous ces concepts
influenceront grandement Jules Luys (1828-1897),
un des grands anatomistes du cerveau au
XIX° siècle, maître de Ritti.
Luys propose, en 1865, dans « Recherches
sur le système nerveux
cérébro-spinal, sa structure, ses
fonctions et ses maladies » de voir «
la couche optique comme le lieu où toutes
les impressions périphériques
viennent se concentrer » (Parent, 2011). De
là va naître la théorie
proposée par Ritti.
-
- Après une biographie de Ritti, nous
allons voir comment celui-ci développe
ses concepts des mécanismes de
l'hallucination, tentant ainsi de
répondre aux questionnements de
Baillarger et Brierre de Boismont. Il
écrit: « Surpris du peu de place que
tient en général la physiologie
pathologique dans les traités et les
mémoires sur l'a1énation mentale,
j'ai voulu, dans ce travail réagir contre
cette tendance. La théorie physiologique
de l'hallucination, que j'ai l'intention
d'exposer avec tous les développements
qu'elle mérite et toutes les preuves
qu'elle comporte, est due à M. le Dr
Luys. C'est dans les ouvrages de cet
éminent physiologiste que je l'ai
puisée. »
-
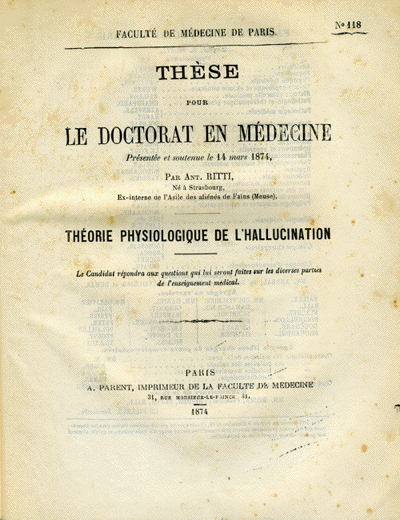 -
- Antoine Ritti
- Né à Strasbourg le 6
février 1844, au sein d'une famille de
commerçants et de paysans
profondément catholiques, il rompt avec
sa famille à 20 ans, refusant la vie
religieuse qu'on souhaite lui voir embrasser et
s'inscrit à la faculté de
médecine de sa ville natale. Conquis par
la philosophie positiviste d'Auguste Comte
(1798-1857), ses premiers écrits, en
1869, dans « La Pensée Nouvelle
» dévoilent son militantisme. Quand
la guerre éclate, il part à Paris
et travaille à l'hôpital
Lariboisière pendant le siège de
la commune. En 1871, son internat l'amène
chez Luys à Ivry. Il y rencontrera
Baillarger, Charles Lasègue (1816-1883),
Jules Falret (1824-1899), Henri Legrand du Saule
(1830-1886), Ludger Lunier (1822-1885) et
Benjamin Ball (1833-1893). Il suit
parallèlement les cours de Jean-Martin
Charcot (1825-1893) et de Thédule Ribot
(1839-1916). Il noue des amitiés
puissantes et déterminantes pour toute sa
vie médicale et d'auteur prolixe avec
Louis Peisse (1802-1880), philosophe fondateur
de la Société
Médico-psychologique et avec
Amédé Dechambre (1812-1886),
coordonnateurs du monumental Dictionnaire
Encyclopédique des Sciences
médicales Dechambre (1864 - 1889). Ritti
y contribuera en rédigeant 20
chapitres.
-
- Compatriote alsacien, Dechambre
présente Ritti à Emile
Littré (1801-1881), lui aussi positiviste
affirmé. Il lui dédira sa
thèse comme il le fera à
Baillarger, à Jacques Moreau de Tours
(1804-1884) et surtout à Luys principal
instigateur de son travail. Baillarger le fait
nommer inspecteur adjoint des asiles
d'aliénés du département de
la Seine. Fort de ces soutiens, il est
nommé, en 1878, médecin de la
Maison Nationale de Charenton en compagnie de
Jules Christian (1840-1907). Tous deux
alsaciens, ils y travailleront de concert et en
harmonie pendant près de trente ans. Il
puisera dans ce contact quotidien avec les
malades hospitalisés les observations
à la base de toutes ses nombreuses
publications, notamment son « Traité
clinique de la folie à forme circulaire
», publié en 1880 et a l'affirmation
de l'origine syphilitique de la paralysie
générale en 1884. Elu en 1881,
secrétaire général de la
Société
médico-psychologique, il en sera
l'âme pendant 38 ans, jusqu'à sa
mort le 23 janvier 1920. Réputé
avoir « la bosse de la
vénération », ce long
règne l'obligera à rédiger
pas moins de 13 éloges funèbres,
d'une qualité historique
irremplaçable (Baillarger, Cotard
etc.), parues dans les Annales
médico-psychologiques pour lesquelles il
assurera scrupuleusement pendant 30 ans, la
fonction de rédacteur en chef (Defaux,
1985; Vernet, 1920).
-
- Les hallucinations expliquées par
Antoine Ritti
- Débutant son exposé par un
argumentaire positiviste, il expose la loi
proposée par Auguste Comte pour
interpréter l'histoire des connaissances
et l'applique aux hallucinations. Cette loi
décrit trois périodes successives
dans l'acquisition des connaissances: (1)
théologique pendant laquelle
l'halluciné est vu comme sous l'emprise
d'une divinité maléfique, (2)
métaphysique pendant laquelle
l'halluciné est reconnu comme un malade
en proie « aux mouvements des esprits
animaux », et enfin (3) scientifique ou
positiviste pendant laquelle l'halluciné
présente une symptomatologie à la
sémiologie reconnue et expliquée
par des dysfonctionnements
anatomico-fonctionnels démontrés.
Se situant délibérément
sous cette ère, il va développer
une théorie basée sur les
découvertes anatomiques de son
maître Jules Luys. Celui-ci a
décrit, en 1865, dans son traité
intitulé « Recherches sur le
système nerveux, sa structure, ses
fonctions et ses maladies » et l'atlas qui
l'accompagne, les structures sous corticales,
identifiant notamment plusieurs noyaux au sein
du thalamus et, sis en dessous, une zone qu'il
va nommer: « la bandelette accessoire de
l'olive supérieure ». En 1877,
Auguste Forel (1848-1931) la renommera Corpus
Luysii (Parent, 2011). Luys identifie quatre
noyaux au sein du thalamus: (1) antérieur
olfactif, (2) centro-moyen visuel, (3) centro
postérieur somato-sensoriel, (4)
posterieur auditif. Il entrevoit les connexions
avec le tronc cérébral et envisage
un rôle de modulation du thalamus,
intermédiaire entre les structures
corticales volontaires et les structures
automatiques du tronc cérébral.
Ritti collecte une trentaine d'observations,
publiées depuis le début du
XIX° siècle en France et en
Angleterre, dans lesquelles « la
lésion, ayant successivement envahie les
deux couches optiques, a amené
successivement ainsi à l'extinction
totale des impressions sensorielles qu'elles
sont chargées de recueillir ». Puis
il décrit des expériences de
lésions ciblées, omettant de dire
quel animal fut utilisé, et
détruisant «les couches optiques
antérieures, source de la perte de
l'odorat, et plus postérieures
entraînant la disparition de l'ouïe
».
-
- Fort de cet exposé, il argumente:
« Nous avons surtout fait ressortir le
rôle important que jouent, dans la
perception sensorielle, les cellules
ganglionnaires de la couche optique,
disposées en amas distincts, formant
quatre centres. Placées anatomiquement
entre l'organe sensoriel externe et l'organe
récepteur, qui transforme les sensations
en idées, les cellules sont
ébranlées par les impressions du
dehors; elles élaborent ces impressions,
souvent y séjournent pendant un certain
temps et sont irradiées dans les cellules
corticales où elles sont perçues
».... « Dans les conditions
physiologiques du fonctionnement intellectuel,
les cellules de la couche corticale du cerveau
sont, dans l'état de veille, incessamment
mises en vibration par des stimulations qui
viennent des centres de la couche optique »
... « D'où il résulte que les
cellules de la substance corticale du cerveau ne
perçoivent que médiatement et par
l'intermédiaire des cellules des centres
de la couche optique les incitations
extérieures. A l'état anormal, le
contraire a lieu. Tout le mécanisme des
facultés intellectuelles et morales
marche alors spontanément, comme si le
frein qui modère et dirige ce rouage si
compliqué, était brisé
». Et Ritti va ainsi proposer une
explication aux hallucinations: « A
l'état normal, les objets
extérieurs amènent l'irritation
des nerfs sensoriels; dans l'hallucination, au
contraire, une excitation interne, celle des
ganglions sensoriels, amène des
représentations perçues par le
malade et qu'il objective, comme si une
impression extérieure venait irriter le
nerf sensoriel ». Ritti conclue son
exposé par un résumé:
« les différents
phénomènes qui entrent dans la
composition du processus morbide d'une
hallucination: (1) l'activité
spontané des cellules de la couche
optique, activité provoquée par
des causes variées; (2) l'irradiation de
cette activité fictive vers les cellules
de la substance corticale; (3)
l'entraînement consécutif de ces
mêmes cellules corticales, qui mettent en
œuvre ces matériaux erronés
avec la même logique que s'il
étaient réels ». Ritti
explique ainsi la persistance des hallucinations
après destructions des organes sensoriels
et « leur enchaînement successif dans
divers sens ».
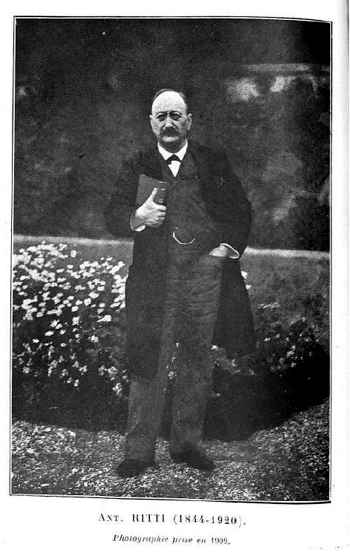 - Conceptions contemporaines
- Le thalamus appartient aux structures
sous-corticales. Il peut être
divisé en quatre territoires fonctionnels
distincts en fonction de la topographie des
régions du cortex cérébral
en relation: un territoire sensori-moteur, un
territoire associatif qui traite la cognition,
un territoire limbique qui traite les
informations émotionnelles et
motivationnelles et un ensemble de noyaux
activateurs médians impliqués dans
l'éveil. Ces structures jouent un
rôle majeur dans la programmation et
l'exécution des programmes moteurs ou
comportementaux. Ces modèles ont permis
d'apporter une explication à
différents troubles moteurs: tremblement,
dystonies, dyskinésies, chorée,
tics, mais aussi ont conduit à proposer
une analogie dysfonctionnelle dans les troubles
psychiatriques obsessionnels et compulsifs, ou
la maladie de Gilles de la Tourette (Carrera,
2006; DeLong, 2007; Utter, 2008).
-
- La description d'hallucinations est
exceptionnelle dans les dysfonctionnements de
ces circuits alors que ceux-ci provoquent le
plus souvent des déficits cognitifs plus
ou moins sévères (Scheibel, 1997).
GR. de Freitas et J. Bogousslavsky rapportent
dans leur chapitre sur les infarctus thalamiques
du traité Subcortical Stroke de G. Donnan
et al, les deux seuls observations, avec
vérification anatomique, publiées
décrivant des hallucinations par
lésion thalamique : Noda et al. (1993) et
Tatu et al. (1996). Il s'agit de 2 cas seulement
sur les 28 cas répertoriés avec
détails anatomiques (autopsie ou MRI)
depuis 1936 d'atteinte unilatérale droite
du territoire paramédian (=
thalamo-perforé) du thalamus (Schuster,
1936). Ces atteintes droites sont celles qui
sont le plus « psychiatriques »,
notamment avec des états
pseudo-confusionnels voire maniformes. Les
atteintes unilatérales gauches et
bilatérales ne rapportent pas
d'hallucination au premier plan, et ce n'est pas
non plus le cas dans les atteintes des autres
territoires vasculaires du thalamus : polaire,
choroïdien postérieur, et
latéro-thalamique ou
thalamo-géniculé. Cette
rareté est en contraste avec la
fréquence des troubles mnésiques
et cognitifs, notamment dans les atteintes du
territoire paramédian et/ou polaire. En
fait, en clinique neurologique, les
hallucinations sont surtout un
phénomène de lésion
corticale des aires sensorielles correspondantes
(hallucinations visuelles simples ou
complexes/métamorphopsies des
lésions occipitales, hallucinations
auditives du cortex temporal latéral
etc.). Par contre, des phénomènes
hallucinatoires somatognosiques comme le
syndrome du membre surnuméraire peuvent
survenir avec des lésions
hémisphériques sous-corticales,
qui sont les seules à pouvoir
entraîner, par une lésion assez
limitée, une paralysie associée
à une déafférentation
sensitive/proprioceptive complète,
élément nécessaire à
la survenue du phénomène du membre
fantôme (Carrera, 2006; Staub, 2006; Tatu,
1996).
-
- Des observations de malades
cérébrolésés ne
permettent pas, en règle
générale, de conclure à une
lésion unique du thalamus pour expliquer
un trouble hallucinatoire: l'hallucinose
pédonculaire associe des lésions
pontiques, du thalamus postérieur et du
cervelet. Alors que les hallucinations auditives
sont exceptionnellement associées
à des lésions individualisables,
les hallucinations visuelles ou olfactives, par
exemple, peuvent révéler une
intoxication chronique (alcool), une tumeur, un
AVC comportant des lésions de
siège variable mais intéressant
des boucles sous-corticales auxquelles participe
le thalamus. Celui-ci intervient aussi dans nos
trois états de conscience: éveil,
sommeil profond, sommeil paradoxal. Les
hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques
sont fréquentes et physiologiques ou
participent au tableau sémiologique de la
narcolepsie, d'états migraineux ou
épileptiques, ou de maladies
neurodégénératives
(Berthier, 1993; Feinberg, 1989; Kölmel,
1991).
-
- Conclusion
- Dans son « Traité des
hallucinations » (1977), Henri Ey
(1900-1977) considère la thèse de
Ritti comme l'un des plus importants textes sur
ce thème écrit au cours de la
deuxième moitié du XIX°
siècle avec ceux de Legrand du Saulle et
Brierre de Boismont. Pourtant Louis Delasiauve
(1804-1893), Falret, François Leuret
(1796-1851) ont laissé un souvenir plus
marquant dans l'histoire de la psychiatrie qui,
comme Carl Wernicke (1848-1905), ne voyaient
dans ces troubles qu'un désordre du
« manteau cérébral »
(Lhermitte, 1951). On peut donc
considérer Ritti comme le
précurseur d'une conception
développée en 1890 par Theodore
Meynert (1833-1892), en Allemagne, d'une
participation sous-corticale aux pathologies de
l'esprit et d'une conceptualisation
contemporaine des phénomènes
hallucinatoires bien que ses explications
anatomo-fonctionnelles apparaissent aujourd'hui
dépassées.
-
- Bibiographie
-
- Baillarger J. Recherches sur l'anatomie, la
physiologie et la pathologie du système
nerveux. Paris. V. Masson Ed. 1872. 428p.
-
- Berthier ML, Posadas A, Puentes C,
Kulisevsky J. Sub cortical environmental
reduplication: SPECT findings in a patient with
a right thalamocapsular haemorrhage. J Neurol
Neurosurg Psychiatry. 1993;56(4):423-4.
-
- Bogousslavsky J, Moulin T. Birth of modern
psychiatry and the death of alienism: the legacy
of Jean-Martin Charcot. Front Neurol Neurosci.
2011;29:1-8.
-
- Boissier de Sauvages de la Croix. Nosologica
Methodica Sistens Marborum Classes. Amstelodami.
Fratrum de Tournes Ed. 1768. 2 vol.
-
- Brierre de Boismont A. Des hallucinations.
Paris. Germer-Baillière Ed. 1852.
720p.
-
- Calmeil L. De la folie
considérée sous le point de vue
pathologique, philosophiqque, historique et
judiciaire. Paris. JB Baillière Ed. 1849.
2 vol.
-
- Carrera E, Bogousslavsky J. The thalamus and
behavior: effects of anatomically distinct
strokes. Neurology. 2006;66(12):1817-23.
-
- Defaux JF. Antoine Ritti (1844-1920),
aliéniste pur ». Thèse pour
le doctorat en médecine.
Université de Caen. 1985.101p.
-
- Delasiauve L. Classification des maladies
mentales ayant pour base la psychologie et la
clinique. Paris. Duval Ed. 1877. 24p.
-
- DeLong MR, Wichmann T. Circuits and circuits
disorders of the basal ganglia. Arch Neurol.
2007;64(1):20-24.
-
- Donnan GA, Norrving B, Bamford J,
Bogousslavsky J. Subcortical Stroke. Oxford
University Press. 2002. 364p.
-
- Esquirol J. Des illusions chez les
aliénés. Paris. Cochard Ed. 1832.
83p.
-
- Ey H. Traité des hallucinations.
Paris. Masson Ed. 1977. 2 tomes.
-
- Feinberg WM, Rapcsak SZ. "Peduncular
hallucinosis" following paramedian thalamic
infarction. Neurology. 1989;39(11):1535-6.
-
- Forel A. Untersuchungen über die
Haubenregion und ihre oberen Verknüpfungen
im Gehirne des Menschen und einiger
Saügethiere, mit Beiträgen zu den
Methoden des Gehirnuntersuchung. Arch Psychiat.
1877;7:393-495.
-
- Foville AL. Observations cliniques propres
à éclairer certaines questions
relatives à l'aliénation mentale.
Paris. Didot Ed. 1824. Thèse 19p.
-
- Kölmel HW. Peduncular hallucinations. J
Neurol. 1991;238(8):457-9.
-
- Legrand Du Saulle. La folie du doute (avec
délire du toucher). Paris, V. Adrien
Delahaye et Cie, 1875. 75p.
-
- Lhermitte J. Les hallucinations. Paris. Doin
Ed. 1951. 230p.
-
- Luys J. Recherches sur le système
cérébro-spinal, sa structure, ses
fonctions et ses maladies. Paris. JB
Baillière Ed. 1865. 2 vol.
-
- Meynert Th. Klinische Vorlesungen über
Psychiatrie. Wien. W. Braumüller. 1890.
304p.
-
- Noda S, Mizoguchi M, Yamamoto A. Thalamic
experiential hallucinosis. J Neurol Neurosurg
Psychiatry. 1993;56(11):1224&endash;1226.
-
- Parent M, Parent A. Jules Bernard Luys in
Charcot's penumbra. Front Neurol Neurosci.
2011;29:125-36.
-
- Ritti A. Théorie physiologique de
l'hallucination. Thèse pour le doctorat
en médecine. Paris 1874, N°118.
76p.
-
- Scheibel AB. The thalamus and
neuropsychiatric illness.
- J Neuropsychiatry Clin Neurosci.
1997;9(3):342-53.
-
- Schuster P. Beitrage zur Pathologie des
Thalamus opticus. Mitteilung : Kasuistik.
Gefessgebiet des A. thalamo-geniculata, der A.
thalamo-perforata, der A. tubero-thalamica und
der A. lenticulo-optica. Archiv für
Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
1936;105:358-432.
-
- Staub F, Bogousslavsky J, Maeder P,
Maeder-Ingvar M, Fornari E, Ghika J, Vingerhoets
F, Assal G : intentional motor phantom limb,
Neurology 2006;67(12):2140-6
-
- Tatu L, Moulin T, Chavot D, Bergès S,
Chopard JL, Rumbach L. Hallucinations and
thalamic infarction. Rev Neurol (Paris).
1996;152(8-9):557-9.
-
- Utter AA, Basso Ma. the basagl anglia: an
overview of circuits and function. Neurosci
Biobehav Rev. 2008;32(3)333-342.
-
- Vernet G. Antoine Ritti. Ann Med-Psychol.
Paris. Masson Ed. 1920;12:100-594.

- Antoine
Ritti (1844-1920) pdf en anglais
- Antoine Ritti
(1844-1920) pdf en français
|